
Quinzième volet
Voyage…
Le sentu
Lecture de Le sentu au gîte le Trait à Redortiers lors de La soupe aux livres le 21 octobre 2018
23 octobre 2018
Douche
Sous le pommeau de pluie
d’un lampadaire
un papillon se douche aveuglément
Il n’a de nuit
que le faisceau trempé de ses ailes
10 octobre 2018
Sous scellés
Soudain, volets de nuit
plaqués à chaque fenêtre
Le temps est sous scellés
on n’approche plus que le silence
Ecrire pour absorber les chocs
Tracer un sillon
soc et charrue de mots
dans la chair lactée des étoiles
8 octobre 2018
Odeurs baoulées
C’était un matin de France
un peu gris, un peu tiède
un peu moite
un peu bleu de ce bleu
dont sont faits les arbres
Avec toi, l’Afrique soudain accessible
à l’odeur d’un plein colis de fruits
et la bouffée d’air froid échappée des valises
et qui sentait l’avion
le bois d’iroko et de fraké
les grains d’un kissoro
Je joue et je rejoue sans fin
la même partie recommencée
27 septembre 2018
Un oreiller d’ailes mortes
A flot continu, la lumière
débondée
Musique aléatoire
Les rues jonchées de petites plumes
flocons d’oiseaux
comme si le ciel avait éventré
un oreiller d’ailes mortes
Veiller encore
dans la distance
entre les paysages dévidés
et la zone d’ombre
cette ombre pansue des maisons
où est assis
où s’épaissit
ce que l’on tente d’oublier
A petits coups déraisonnables
le silence martelé
répète, répète
un brin sans dessus dessous
un brin de sens caché dessous
Dessus est simplement posée
à flot continu, la lumière
23 septembre 2018
Rouge et noir
Tu as effacé ton paysage
désert rouge et noir-couchant
Elle n’avait plus de vitres
la fenêtre adossée au vent
Cette fenêtre posée sur le sable
D’un côté tu avais mis du rêve
de l’autre j’avais des visions
Tu as franchi le cadre nu
Alors toutes les lunes se sont déployées
et la nuit a changé sa trajectoire
Effroyable silence
à en faire éclater le monde
Tu as effacé ton paysage
couchant rouge et noir-désert
La fenêtre adossée au sable
cette fenêtre posée sur le vent
20 septembre 2018
A propos de Matrie de Michel Diaz

MATRIE
Colette Daviles-Estinès
éditions Henry (2018)
« Connaître son origine » écrit Colette Daviles-Estinès au début de la postface à son recueil, posant là, dès ces mots, le sens de la démarche poétique qui conduit son ouvrage et le but de sa quête. Et elle s’en explique: « Bringuebalée sur la planète depuis ma naissance, déracinée, transplantée, déracinée encore et encore, j’ai toujours été fascinée par les gens qui étaient en mesure de dire qu’ils venaient d’un pays particulier, d’une région bien précise, le nom de leur famille est écrit sur les tombes de la moitié du cimetière de leur village. »
Le terme « d’expatriation » n’est certes pas tout à fait synonyme de celui « d’exil », mais il peut recouvrir les mêmes douleurs engendrées par les mouvements tragiques de l’Histoire des hommes et la complexité des relations que ceux-ci entretiennent avec les lieux du monde où ils ont vu le jour, avec le monde, simplement, dans la globalité de son espace. Quoi qu’il en soit, nous voici, dans ce recueil, à l’opposé des sentiments et de la poétique du poète Adonis qui fait de l’exil sa plus précieuse et sa plus forte revendication, sa seule légitimité à être et à écrire, puisque, pour ce dernier, nous ne pouvons, ni ne devons, nous inscrire dans aucun lieu, que l’exil est le seul territoire possible à l’homme et au poète, et que le seul chemin de liberté où il peut avancer est celui de l’errance assumée, vers un lointain inaccessible, son unique patrie.
Evoquant la complexité liée aux origines de sa propre histoire, Colette Daviles-Estinès écrit, quant à elle, dès les premières pages de son ouvrage: « Des années que je porte cette histoire / sans trop savoir / par quel bout la prendre. »
En effet, d’évidence, l’auteure ne sait trop par quel bout la prendre. En inversant les mots « d’aller-retour » pour parler de ses deux voyages au Vietnam où elle est née (et dont elle n’a aucun souvenir), et en en faisant deux « retour-aller », elle indique bien où sont ses vraies racines affectives, celles aussi « du sang », ce territoire qu’elle nomme « matrie » faute de pouvoir revendiquer l’espace d’une plus authentique patrie. Pourtant, en même temps, les courts poèmes qui composent cet ouvrage, consacrés à ces retours vers la terre natale, s’apparentent plutôt à des pages de « carnets de voyage » où s’expriment d’abord l’émotion, l’étonnement et le ravissement de la découverte plus que le sentiment de la re-découverte ou de la re-connaissance de cette terre, puisque celle-ci n’existait que par ce que lui avait légué, de longue date, la mémoire familiale.
« Pour être expatriée, il faudrait d’abord avoir une patrie » dit l’auteure dans le même texte de postface. C’est bien là le problème de tous ceux qui se sentent déracinés, qui se sentent toujours plus ou moins étrangers dans le pays où le hasard des événements les a très tôt jetés, ou celui dans lequel ils ont choisi de vivre, de ceux-là qui, parfois, doivent tout apprendre et, pour les autres réapprendre, de leur pays natal.
Si je puis me permettre ici une très brève parenthèse, je me contenterai de dire que je suis d’autant plus sensible à l’expression de ce déchirement que, partagé moi-même, depuis toujours, entre trois pays, trois cultures, je n’ignore pas que, souvent, on ne peut sauver son identité qu’en revendiquant, comme le fait Colette Daviles-Estinès, son statut de « citoyen(ne) du monde ». Mais j’employais la formule de « carnets de voyage » car la plupart des titres de ces poèmes (et leur contenu) nous permettent de le faire, même nous y incitent, par exemple: « Dubaï Bang-kok », « Hö-Chi-Minh-Ville », « Minh Chan Hôtel » « Niakoué », « Savourer le voyage », « Mékong », « Hôi An », « Baie d’Ha Long », « La dix-neuvième chambre », « Hué, le rêve » ou « Bus de jour ». Pages de carnet poétique à l’écriture exquisément sensible aux objets et formes du monde, aux rumeurs de la vie, des villes et des rues, aux voix qui les animent, aux odeurs, aux saveurs, aux éclats des lumières sur l’eau. On tombe ainsi, à chaque page, sur de savoureuses trouvailles de langage où se condense la plus pure poésie. Celles-là, presque prises au hasard: « je cherche le vent rouge / dans la mémoire du ciel », ou « ce pan de miroir où plisse / une aube de safran », ou « on entend la pluie frire sur les toits », ou encore « Je capte la lumière / qui crawle et se délite / à la surface de tout ce qui onde. »
Ces pages, qui ressemblent davantage à la narration d’une errance qu’à un voyage qui aurait prévu sa destination, sont aussi l’occasion, bien évidemment, d’évocations d’ordre autobiographique qui entrent dans le cadre de la « quête des origines ». Le premier poème, « Puzzle », en pose les premiers éléments, et le titre de quelques autres en consolide le parcours: « Le consulat », « Mamie Louisa », « Mon sang du nord » ou « Au nom des pères ». Là encore, une écriture sûre sait trouver le point d’émotion, comme dans « Hai Phong /…/ Port qui n’en finit pas / de traverser l’écume naphtaline / tous flamboyants éteints ». C’est dans ces textes que la voix de Colette Daviles-Estinès semble retrouver, tout spontanément, comme remontée du fond d’elle-même et à son insu, des accents de petite fille: « Nous avons longé le pâté de maisons / C’est un gros pâté, ta maison, Papa », ou encore, à propos de sa grand-mère: « Je l’imaginais assise en amazone / derrière son prince charmant / sur la croupe d’un cheval blanc ».
Ce recueil de poèmes, dans lequel le regard se tourne vers le visage du pays perdu, retrouvé, et réapproprié par l’écriture, comme l’on reconstruit avec les éléments de la réalité les images d’un rêve, n’est pourtant pas porteur d’une nostalgie qui verserait dans l’effusion. Mais il est l’expression d’une douleur toujours ouverte, ferment d’un « chant profond » où se dit que notre appartenance au monde ne va jamais de soi. Et que, pour y trouver sa place, il faut, pour quelques-uns, y chercher et y labourer son territoire de parole, y déposer ses mots, comme en terre d’asile on pose son bagage pour y trouver quelque repos. Dans ce qu’il offre de matière poétique, ce livre de l’errance est aussi le livre d’une halte, celle d’une mémoire en partie retrouvée, reconstruite, « balayée d’ombre sous le vent » mais offerte un moment à l’apaisement et à ce qu’il permet de possible partage.
Michel Diaz, 13/09/2018
A propos de L’or saisons de Clément G. Second
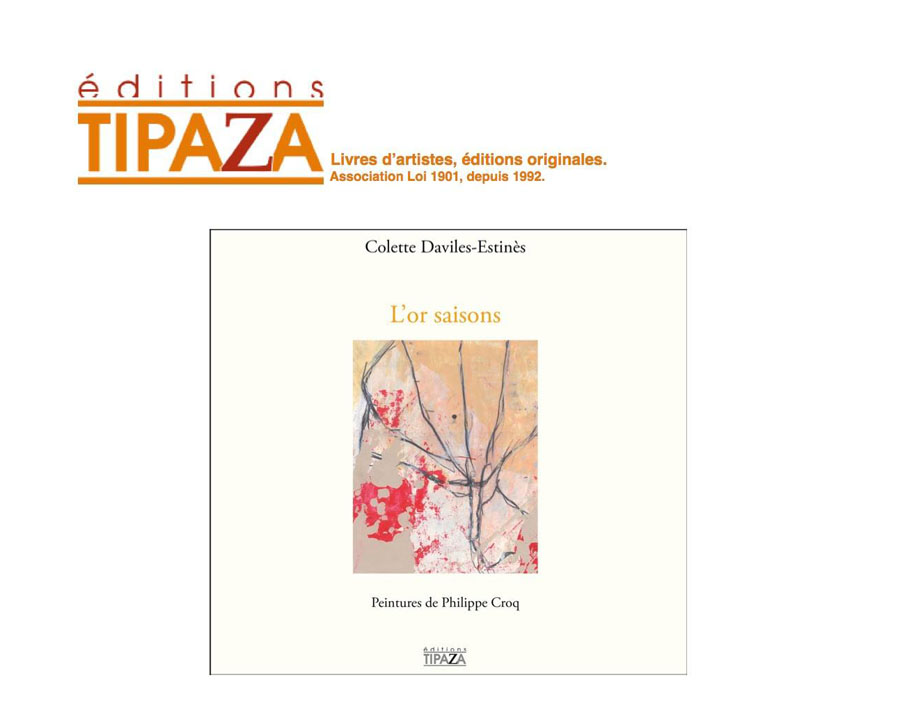
Une Orpailleuse de finitudes
L’or saisons
de Colette Daviles-Estinès
illustrée par Philippe Croq
(Éd. Tipaza, 2018)
Qui, avant de le tenir enfin entre ses mains puis d’y engager ses regards, ne le connaissant pas encore mais l’ayant un peu deviné par assiduité aux Volets ou vers, le riche blog accueillant de la poète, et aux revues, au chaleureux Lichen d’Élisée Bec dont chaque numéro publie de ses textes en particulier – qui donc ne s’ennuyait souvent, impatiemment, de L’or saisons ?
Dans cet ouvrage aux pages végétales, branches-feuilles souples accolées au tronc du dos, les poèmes de Colette Daviles-Estinès fascinent par une constante beauté diffractée en inflexions menant très loin, et l’art de Philippe Croq intercale des peintures polysémiques comme autant de superbes jalons et relais complices.
Sa découverte, lexique et picturale, procure un multiple plaisir, un enchantement. Étrangère au virtuose, au péremptoire, au savant, mais au contraire amie des présences et signes, les apprivoisant, les creusant, s’y apprivoisant aussi, proposant en partage tout un cheminement parmi eux, la parole inspirée de Colette Daviles-Estinès suscite ce rare bonheur.
Parole traversée, et du lent, nuancé tournoiement des saisons rendu par un paysagisme lié à l’intériorité, et de saisies instantanées touchant parfois à la captation pure, et d’une vivance (selon le mot de la poète) évolutive à même le truchement varié, complexe, du monde, non abstraite de lui. Parole-tentative et parole-découverte, à la fois très vibrante, chatoyante et d’un tracé si sûr, comme nécessaire, avec ce quelque chose de parfait d’un geste calligraphe. On devine par quelles mailles fines, quelle exigence personnelle sans préjudice du naturel, de la fantaisie même, quel dû à la Langue aussi, d’abord et toujours, l’attention à l’alentour et à soi de Colette Daviles-Estinès infuse, passe et passe, se tamise jusqu’à l’obtention d’un parachevé – sans prétention, à l’instar de l’absence de majuscule à l’or du titre.
Les citations se bousculent ; en voici plusieurs dont on identifiera ou devinera les liens avec les traits ci-dessus dégagés (pardon pour les poèmes ainsi morcelés, mais ces passages devraient donner envie de les lire…).
Accrocher un verbe bleu aux phrases du vent (Arrimer en pays d’automne, p.19)
Le souvenir est neuf, je l’ai puisé demain (Le courant des rivières, p.23)
Jeter à la mer / l’amer des choses (Avec des si, p.25)
Je passe à gué ma solitude / Le ciel se propage (Éternité, p.29)
Prendre le pouls de l’hiver / Aux poignets nus des arbres (Un hiver au soleil, in Albâtre, p.48)
C’est à se prendre les pieds dans la lumière (Le temps se lève, in Albâtre, p.48)
Frotter les mots – têtue – / aux tessons de la nuit / User beaucoup de silence (Têtue, in Nocturnes, p. 60)
C’est plein de vivance dans ma vie (La vivance, p.74)
C’est du silence qui traverse / noir velours / une pipistrelle (Pipistrelle, p.89)
Une mouche fouille la chair de l’air / elle vibre et s’agace / au carreau bleu du jour (Chaleur, p.90)
Jour bleu torride / compact / Façade de ciel lisse / Aucune prise sur les mots / et j’écris que / je n’écris pas / Soudain l’invisible déchirure / d’un avion à réaction / … / Aucune trace pourtant (Bleu, p.93)
Écrire, et pourquoi non ? / … / Pourquoi non, le chiendent ? / Et même l’ombre, oui / même l’ombre rayonne, vénéneuse / épanouie (Et pourquoi non ? p.114)
Justement / il y avait comme une buée / sur les carreaux que je n’avais pas [Vers à travers verres (correcteurs), p. 121]
… Mais L’or saisons offre davantage à qui le découvre. Le recueil accède à la plénitude de cette première identité par la grâce d’un mouvement foncier de désir poétique qui de bout en bout le mène.
Au nombre des entrées plausibles dans le cœur de l’ensemble, celle-ci en particulier apparaît porteuse de pertinence. Il s’agit d’un désir incluant le courage d’être et de faire (selon l’étymologie du mot poésie) quelles que soient les variations intérieures ; d’assumer la Parole et ses valences, ses gratifications, les douleurs qu’elle met au jour, ses possibles dangers, ses ravissants inattendus. D’un poème à l’autre, l’audace du dire est un enjeu que gagne la loyauté ferme avec soi, le réel et la langue. Il y va de la métabolisation en substance de partage des ressentis qui visitant la poète la touchent, la mobilisent. Une énergie, volonté et amour de la vie confondues, la pousse à embrasser toutes choses éprouvées – dans un élan toutefois indemne d’illusion.
Car Colette Daviles-Estinès n’est pas dupe des limites du chemin, des données fuyantes ou adverses de l’existence : en un mot-clef, d’aucune finitude. Si par exemple mélancolie, solitude, nostalgie, sentiment de vanité ou d’insuffisance n’ont pas le dernier mot de ses pages, ils les visitent, que ce soit en sourdine ou par élancements, concurremment aux inclinations heureuses, confiances, sourires, rencontres du beau, déclinaisons du sens. Comment en serait-il autrement dans une vivance authentique dénuée d’auto-bercement ? Dès lors, que faire dans l’émouvant ici de vivre, marqué d’une façon ou d’une autre, même partiellement, par la carence ontologique ? Combien, à la place de la poète, verseraient dans le ressentiment ou la plainte, ou encore le désabusement esthétisant, etc. Le cap tenu par elle n’a rien à voir avec de telles compensations. Son cours est quête d’un lointain de profondeur, quête toute de sincérité, de présence réceptive et questionnante, intense, recueillie même, parfois échardée d’un vertige de pari ou aiguillonnée d’humour, « Allant vers » (on aura reconnu le début du titre de son précédent, superbe livre de poésie) la part de non-leurre, le petit peu à l’épreuve des mélanges, la fine pointe qualitative, le presque rien précieux, infime éparpillé ou ondoiement furtif, tremblant, comme fragile, friable, palpitant autour de la poète et en elle, ineffable mais décelable, approchable, intimement vécu et transmis par la grâce des mots et silences mutuellement accordés… l’or des saisons soi-même, poussière, paillettes et pépites de toutes les saisons et aspects d’une voie de par le monde. Et au moins autant, à travers ces scintillements, veine mise au jour d’un pur talent confirmé de haut carat incontestable.
Si l’interprétation sous l’angle du désir poétique n’en exclut pas d’autres éventuelles, la lecture et relecture attentive de ces pages immersives et souvent bouleversantes convainc de sa validité. Les citations qui suivent par exemple, quelques-unes parmi tant d’autres possibles, présentent plus que l’apparence d’une justification. Mais qu’elles servent avant tout, comme les précédentes, la vérité d’une œuvre magnifique. Qu’elles invitent à y entrer.
j’ai joué ce qui reste / j’ai gagné ce qui vient / le vent charrie du ciel, les oiseaux des rivières / ma vie, un allant vers (La vie en crue, p. 40)
Existe-t-il une pause dans le temps / Dans l’espace ? / Se dire je souffle un peu / … / un non-lieu / en fin / au large de toutes les nuits ? (Non-lieu, p.46)
Du bonheur plein le regard / Juste ce regard-là / sans se retourner (Aube, p.51)
J’échangerais tous les oublis / pour une seule parcelle de mon trajet inachevé / infini / Soif de vivre / une vie à tous les vents (Soif, p.54)
Le bec d’une tourterelle / un brin occupé…(Printemps, p. 55)
Je m’approprie le soir boisé / – la part rauque des chevreuils– / et j’ai la clef de la rivière (Ici, p.73)
À vrai dire je ne sais que faire / de ces vers cueillis dans l’été / tels des bribes de songe /… / Seulement un poème / dans le sens des aiguilles / à détricoter le temps (Champêtre, p.76)
Et dans le torrent, le soleil / rush d’étinclles à flot bouillon / … / Ce peu de loin / entre les mailles (Ce peu de loin, p.78)
Ce silence est-il truqué ? / … / Je peux aimer longtemps ainsi / attendre / que le ciel s’averse (Et cette nuit ? p.99)
Cascadent les chants d’eau / des ruisseaux qui assaillent chaque porte de la terre / Laisser au bord des routes / les parapets flanqués de bouquets de mémoire / … / Je suis riche héritière de l’aube et de son souffle (Remise de peines, p.109)
Faire ce que je dois : / … / Laisser filer les rives / la rivière / les passeurs de comètes (Ce tout poème, p.113)
Qu’importe si le vent ressasse la lumière / c’était vivement vivre / vivement vivre loin (Ce livre, la vie, p.128)
Voici enfin un poème (p.126) retranscrit en entier. Qu’on y trouve, condensés, le don de simplicité magique et la façon d’être si attachante, humaine parmi les humains, de la poète – autant dire, son exemplarité.
Laisse dire
On m’a dit c’est bleu
ce que tu écris
On m’a dit mais
c’est bleu nuit
Alors aujourd’hui
je n’ai prononcé que des oiseaux
Ils battent de leur aile
le parvis des jours
…À présent le livre est reposé. Le regard le quitte.
En deçà du regard, cette sensation, claire comme une certitude, que l’or saisons fait mieux que d’habiter les pages.
Il y germe.
Clément G. Second
septembre 2018
Sonnailles
Un troupeau coule le long des lavandes
L’eau des sonnailles
irrigue le silence
7 septembre 2018
Enfances
Toi, tu tombais des falaises
de chacune de tes nuits
Tu tombais, tu tombais
ricochets de sanglots
Moi, c’étaient des planètes
qui tombaient, qui tombaient
qui me tombaient dessus
L’enchanteur effrayant
surgi on ne sait d’où
et poupées barbouillées de feutre
à cloche-pied nu
sur la marelle disloquée du monde
5 septembre 2018

Commentaires récents